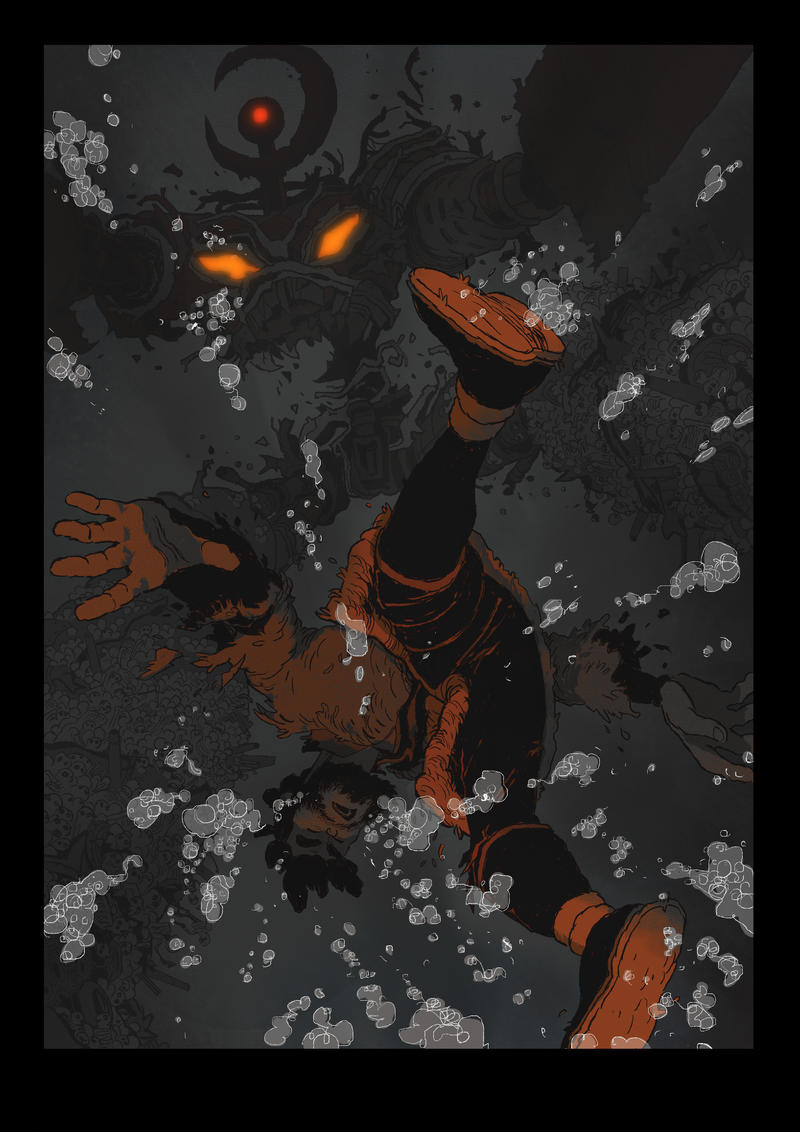Essai d’histoire des négociations climatiques, paru en 2023. Sujet qui m’intéresse, et essai facile à lire. Je recommande.
La demande de l’interdiction des jets privés comme symbole de la consommation ostentatoire et climaticide est montée en puissance en 2023, mais le gros de l’impact climatique des ultra-riches n’est pas lié à leur consommation, mais à leurs investissements. L’empreinte carbone du patrimoine d’un·e Français·e moyen·ne est de 10,7TCO2eq. Celle du patrimoine d’un milliardaire français : 2,4 millions de TCO2eq. Ce patrimoine est potentiellement impacté par le changement climatique. Les plus riches sont à la fois forceurs de climat et vulnérables au climat.
Deux stratégies classiques pour faire face à cette vulnérabilité :
- le prepping version milliardaire (ranchs géants avec bunkers)
- la jet-set climatique (Al Gore & Jane Goodall), qui milite pour remplacer le capitalisme fossile par un capitalisme vert, avec efforts d’atténuation et d’adaptation via le marché, et une vision de nouvelles opportunités de marché pour celleux qui s’engagent dans cette voie. Ceux sont principalement elleux, via leurs financements et leurs relais médiatiques, qui orientent le discours dominant et le débat sur le climat. Le livre se concentre sur cette seconde stratégie.
I Une conscience climatique de classe
Dès 2006 dans la Silicon Valley et 2007 à Londres, dîners d’affaire des « philanthropes climatiques » pour sensibiliser de plus grands pans des élites et décideurs aux enjeux climatiques, et aux investissements possibles pour à la fois y remédier et avoir de nouvelles opportunités d’investissement.
Vont ensuite influencer le débat public pour appuyer l’idée que la transition se fera via des solutions technologiques et des mécanismes de marché ; ainsi leurs intérêts propres en tant qu’investisseurs dans ces technos est rejoint par l’intérêt général, et les États vont assumer une partie des risques à leur place en subventionnant, finançant et en renflouant ces investissements si besoin. Cette stratégie, c’est militer pour une réforme à la marge du capitalisme (changement de cible des investissements) pour ne surtout pas en sortir (Le Guépard, tmtc): on reconnaît qu’il a causé des problèmes, mais on affirme dans le même temps qu’il est la seule solution à ces problèmes.
Les fondations pour le climat fondées et financées par des milliardaires philanthropes vont faire infuser dans le monde associatif le discours managérial : elles se décrivent comme des fondations « à impact » visant un « retour social sur investissements ». Le cadre des entreprises gérées avec des tableaux excel est légitimé, et les entrepreneurs deviennent une figure centrale des politiques climatiques.
II Poumons de la Terre et pompes à fric
Investissement dans les terres de la part des philanthropes verts : un investissement plutôt bon marché et qui prend de la valeur avec le changement climatique : puits de carbone potentiels, et production de denrées agricoles dans un monde où l’incertitude sur cette production augmente. De plus, bon en termes d’images, se posent en défenseur de la terre et de la Nature, surtout si soutiennent des projets de réensauvagement (qui augmentent le potentiel de séquestration carbone). Se posent ainsi en individus responsables, qui compensent à titre individuel leurs émissions carbone (liées aux déplacements en avion privé par ex). Permet d’opposer la figure du bon philanthrope à celle du mauvais pauvre, et de pousser un discours néomalthusien : le pb c’est la surpopulation.
Les forêts déjà existantes étaient initialement exclues des mécanismes de compensation carbone : seuls les projets d’afforestation et de reforestation étaient éligibles. L’inclusion de la déforestation évitée a permis d’inclure les forêts existantes comme des actifs valorisables sans rien faire d’autre dedans que de ne pas les raser (point positif quand même : ça leur offre une protection qu’elles n’avaient pas sinon), ce qui permet surtout d’augmenter la valeur de la propriété foncière de certain.es (point positif à nouveau : ça peut inclure des États du Sud qui sinon n’avaient pas trop de billes dans les négociations climatiques). Le problème est que le fait que le mécanisme de REDD (protection des forêts et émissions de crédits carbone en échange) apporte effectivement une protection supplémentaire (plutôt que protéger des forêts qui n’allaient de toute façon pas être coupées) est assez invérifiable, qu’on agglomère des actifs fonciers très différents, et que du coup le tout est une usine à gaz où il est facile de gruger, et qui sert principalement à enrichir un oligopole de certifieurs qui servent à patcher les failles d’un système qu’ils ont eux-mêmes monté…
Le mécanisme REDD, initialement prévu pour les forêts tropicales, a été étendu aux forêts tempérées, ouvrant une superbe opportunités aux propriétaires fonciers occidentaux. Cette extension a permis une alliance objective entre ces propriétaires fonciers souvent conservateurs et conservationnistes, et les philanthropes verts, souvent plutôt issus d’une élite libérale et tech-friendly. Reconfiguration des liens affinitaires parmi les classes dominantes.
Ce mécanisme renforce l’idée que c’est la marchandisation de la Nature qui permettra de la sauver elle et le climat. Et si cette Nature appartient à des personnes privées, c’est un nouveau mouvement des enclosures, et un capitalisme de rente qui se réaffirme.
III L’éléphant dans la pièce
McKinsey en tant que cabinet de conseil majeur qui appuie aussi bien des acteurs privés que des gouvernements et qui se veut poussant des sujets pas encore appropriés par ses clients, a joué à partir de 2007 un rôle majeur dans la promotion du capitalisme vert comme moyen de poursuivre le capitalisme. Ils ont notamment produit une courbe des coûts marginaux de différentes options de réduction des gaz à effet de serre, qui a été énormément reprise et a beaucoup influencé le débat public, malgré des failles méthodologiques et une absence de transparence sur sa construction. Promeut à la fois l’idée que l’inaction climatique est un non-sens économique et que les solutions pertinentes sont des solutions de marché. McKinsey a publié pas mal d’études en 2006-2007 pour apparaître comme une référence crédible et reconnue sur le sujet. Sans être directement à la manœuvre, elle s’est appuyée sur le rapport Stern (qui a inspiré la courbe des coûts marginaux) qui trace une roadmap pour les entreprises, et a aidé en sous-main à la rédaction du rapport « Design to win » qui traçait une feuille de route pour la philanthropie climatique et a effectivement aidé au fléchage de fonds depuis des fondations provenant de la tech vers ce sujet.
A partir de 2008, le project Catalyst (projet monté et piloté par McKinsey) va être financée par des fondations philanthropiques, versant de 2008 à 2012 42 millions de dollars à McKinsey pour développer une vision de la transition bas carbone et des mécanismes à mettre en place. Sans surprise, elle passe par des engagements volontaires non-contraignants et des mécanismes de marché. Va s’éloigner du fonctionnement de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) en traitant certains acteurs non-étatiques sur un pied d’égalité avec les États (plus grande ouverture), mais aussi en n’intégrant que des acteurs considéré comme essentiels (plus grande fermeture), ie les élites économiques et politiques. A son maximum, rassemblait 150 personnes réparties en 6 groupes de travail, avec une production qui a fortement influencé les accords climats subséquents, en limitant l’interventionnisme étatique sur le sujet (sauf pour la collectivisation des risques et investissements) et en laissant dans l’ombre la question de la justice sociale et des réparations. Mais la mise en place de toute cette diplomatie parallèle (et notamment l’appui la construction d’un texte alternatif par le gouvernement danois + quelques autres au lieu de passer la recherche habituelle d’un consensus entre tous les acteurs) a participé à l’échec des négociations de Copenhague (COP 15, en 2009), même si sera réintégré dans l’accord de Paris. L’échec de Copenhague a en parallèle montré l’importance de la communication autour des solutions vertes que les acteurs privés souhaitent pousser, pour qu’elles bénéficient d’une adhésion suffisamment large.
IV Make our blabla great again
En amont de la COP 21 (accord de Paris, 2015), beaucoup d’efforts de communication pour que différents acteurs soutiennent (ou au moins restent neutres/silencieux) sur l’accord malgré son niveau d’engagement pas si élevé (en dessous de celui de Copenhague notamment), en leur expliquant que la réussite de l’accord en dépendait, et qu’être contre ferait le jeu des négationnistes climatiques et des idéalistes climatiques (ie deux groupes pourtant totalement opposés, ceux qui veulent freiner et ceux qui veulent aller plus loin, classique stratégie centriste de dire qu’iels sont les seuls raisonnables). Les scientifiques notamment ont été approché·es pour un soutien à l’accord, ce qui a marché pour une partie d’entre elleux.
Post-Copenhague, le GSCC (structure financée par des fondations climatiques) a repris en main la communication du GIEC, proposé du media-training aux scientifiques, produit des synthèses des rapports, des communiqués de presse et des argumentaires, pour « restaurer la marque GIEC ». L’objectif était d’augmenter la crédibilité du tout – et de le mettre au service des solutions de marché. L’idée était de ne pas tant avoir des accords dont le fond était ambitieux que des accords dont la forme et la communication autour faisait de la lutte contre le changement climatique via les solutions de marché une évidence largement acceptée.
Ironiquement, cela a été fait en copiant les méthodes employées par les firmes fossiles pour faire de la désinformation sur le climat : astroturfing, financement de groupes d’experts, lobbying… Le problème c’est qu’en en passant par là et en mettant en scène une opposition binaire entre pro et anti-climat, on permet à toutes les entreprises qui sont ok avec mettre en place une communication greenwashée de se réclamer du camp progressiste tout en continuant le business as usual. Plus encore, les grandes entreprises avec des gros budgets (notamment de R&D et de comm’) peuvent dire qu’elles sont des parties de la solution (après mise en place de « conseils scientifiques », partenariats avec des ONG, normes internes, coucou Total et l’IPIECA). Parallèlement, celleux qui contestaient ce cadrage capitaliste se sont retrouvés marginalisés : on n’a pas le temps de renverser le capitalisme, l’urgence climatique est bien trop urgente, et il faut rassembler tout le monde, pas s’opposer aux entreprises de bonne volonté !
Multiplication aussi des visages de la cause climatique, depuis l’historique Al Gore : plein de philanthropes, maires de grandes villes, stars, qui peuvent pitcher l’urgence climatique et les solutions capitalistes, et qui vont dans tous les grands sommets mondiaux et émissions télévisées pour délivrer un message prépackagé.
Création de tout un écosystème de forums climatiques qui tournent en vase clos et où s’échangent des messages d’optimisme indépendants de la lutte contre le changement climatique (l’important c’est de mobiliser). Communication très pro, où les grains de sable sont très rares et même quand ils arrivent, la comm’ arrive à remettre l’événement sur les rails (exemple de l’intervention d’une activiste lors d’un sommet qui sort du script lors d’un échange avec le PDG de Shell, et de l’animation de la table ronde qui dépolitise immédiatement son message en le mettant sur le compte de la douleur que « nous ressentons tous face à ce que nous avons perdu » : recréation d’un collectif, rejet du message en le disant basé sur l’émotion plus que la raison).
V Une photo avec Greta
Les COPs sont centrales dans les négociations climatiques. Tous les acteurs qui veulent influencer sur le discours et processus climatiques sont obligés de s’aligner sur leur tempo. Mais le fonctionnement des COPs est décidé par les États et élites, forçant donc à s’adapter à leur cadre et facilitant une potentielle récupération, en orientant leurs mobilisations vers la demande d’accords climat légèrement plus ambitieux mais surtout adoptés : si le mouvement climat n’insiste que sur l’urgence climatique et le besoin d’accords, il sert in fine d’appui aux groupes d’intérêt néolibéraux et technosolutionnistes qui, à l’intérieur du processus climatique, poussent ces éléments de langage aussi et leurs solutions comme la bonne réponse. Certains acteurs internes vont approuver le mouvement climat publiquement (tant que revendications modérées et actions non-violentes), sous-entendant qu’ils sont tous dans le même camp. Le GSCC a même fourni un appui technique et logistique à Greta Thunberg pour faciliter ses prises de parole, en appui des sommets climatiques internationaux, légitimant un peu plus ces sommets.
Ccl : Faut-il manger les riches ?
Les riches sont une classe consciente d’elle-même, qui met d’énormes moyens pour influencer le discours climatique. Il ne sont pas juste pollueurs (massifs) sans s’en rendre compte, ils ont conscience des enjeux et orientent les solutions selon leur propre agenda. C’est bien cet agenda et la poursuite d’un capitalisme « vert » qui ne renonce pas à la croissance ni aux inégalités qui est la racine du problème. L’urgence est climatique et sociale, climatique et démocratique.