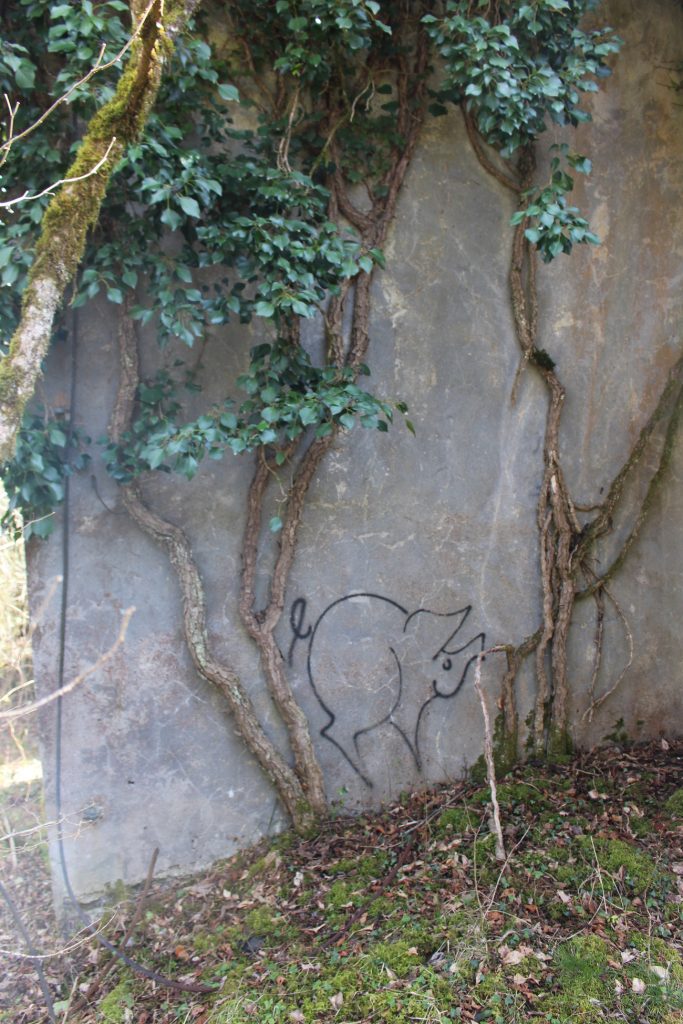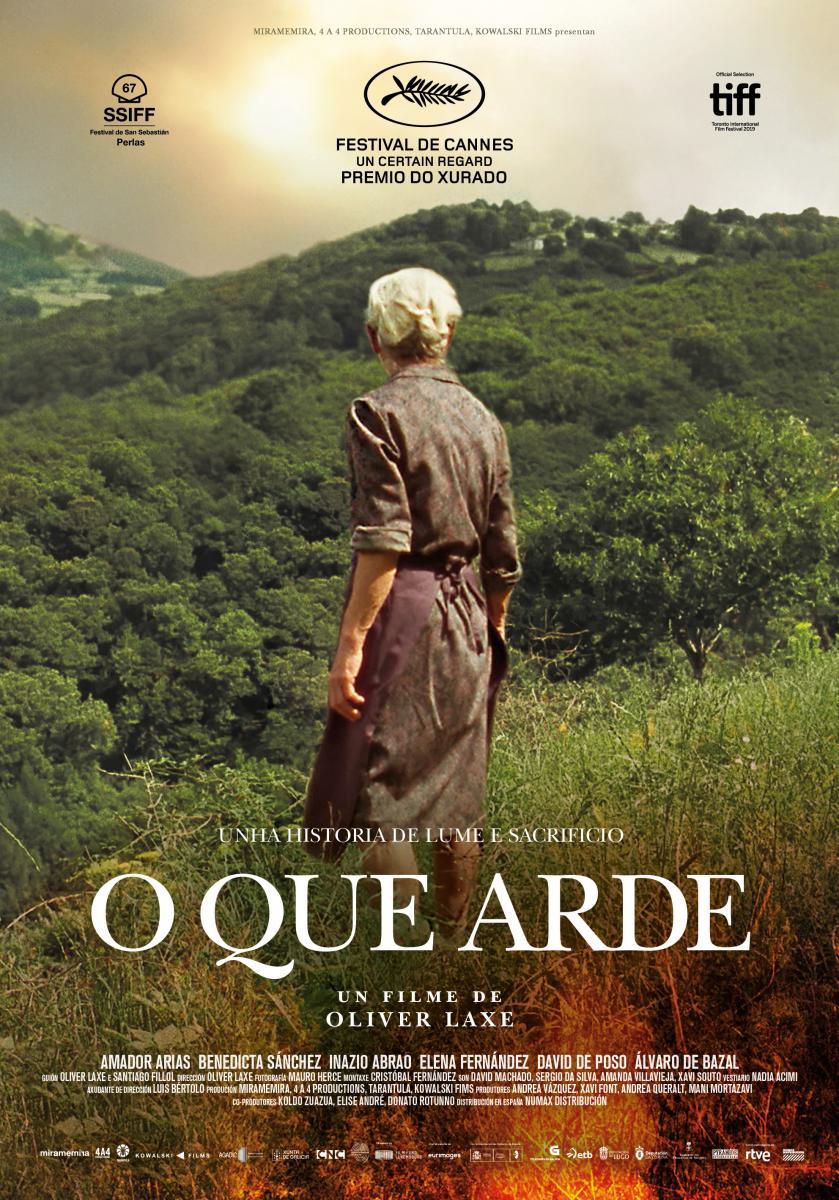Essai politique qui revient sur l’histoire du mouvement autonome, de sa naissance dans les usines italiennes jusqu’à ses évocations sur les rond-points des Gilets Jaunes. L’auteur donne une définition de l’autonomie : articuler à la fois des revendications et une lutte pour sortir la société du capitalisme, et la mise en œuvre immédiate dans son quotidien d’une sortie personnelle du capitalisme, en refusant partiellement ou totalement le salariat, en vivant en communautés autonomes et dans des squats, en pratiquant le parasitisme social (détournement d’électricité, vols dans les magasins, sociabilité et/ou activité productive alternatives…), ce que l’auteur définit comme un communisme immédiat.
L’auteur détaille les différents groupes qui se sont revendiqués ou inspirés du concept : d’abord les ouvriers opéraistes italiens, qui veulent non pas aménager le cadre dans lequel ils travaillent comme dans une revendication syndicale, mais bien s’autonomiser de ce cadre, revendiquant qu’ils ont autre chose à faire de leur journée que produire ou que produire dans le cadre de l’usine avec sa hiérarchie. Ça passe par des sabotages, des grèves sauvages, différentes formes d’actions dans l’usine ou à l’extérieur. Il détaille comment ce mouvement va monter en puissance dans l’Italie des 30 Glorieuses, s’étendre au delà des cercles ouvriers pour être approprié aussi par les étudiant.e.s, et intégrer d’autres revendications que celles liées à l’opéraïsme : féminisme, revendications LGBT. Le mouvement autonome se constitue de groupes voire de groupuscules affinitaires : les hiérachies formelles ne sont pas reconnues, donc pas de structure telle qu’un parti ou un syndicat. Rejet des syndicats existants comme participant à l’aménagement du cadre existant (le reproche classique de cogestion des conditions de travail avec le patronat). Les mouvements féministes et LGBT qui intègrent le mouvement autonome vont rejeter les hiérarchies genrées et hétéronormées des orgas de gauches structurées comme celles du capitalisme, mais aussi logiquement celles du mouvement autonome lui-même, avec ses postures virilistes et la romantisation de la violence. Tout le chapitre sur les mouvements féministes qui se réclament de l’autonomie était vachement intéressant. L’auteur détaille aussi comment l’Autonomie va se focaliser sur la contestation de la Métropole (au début du chapitre je pensais que c’était au sens luttes anticoloniales mais non – et c’est peut-être un thème qui manque dans le livre, si ça a correspondu à une réalité) au sens de la ville néolibérale totalisante ; c’est notamment tout le mouvement d’ouverture de squats en Italie et en Allemagne. L’auteur détaille un peu la trajectoire du groupe Camarades en France, qui serait ce qui s’est le plus rapproché d’un noyau de militants autonomes en France, mais dans un mouvement beaucoup moins d’ampleur qu’en Italie ou Allemagne. Il raconte aussi comment la fin des 30 Glorieuses – où l’État tolérait ce genre d’alternatives et où l’abondance relative de la société sans chômage de masse facilitait le fait d’avoir un mode de vie alternatif – va aussi signer le déclin de ce mouvement en Italie et Allemagne, avec une répression largement accrue, et une polarisation sur des affrontements armés avec l’État (le cas le plus connu étant celui des Brigades Rouges), qui va faire disparaitre les modes de vie alternatif au quotidien.
C’était fort intéressant, et sur un sujet que je connaissais assez peu. Les questions de parasitisme/banditisme social et de toute la tension entre actions d’éclat/participation aux luttes ponctuelles d’une part et vie quotidienne alternative d’autre part était très intéressante.
Je recommande