Visite des expos inaugurales de la Bourse du Commerce. J’ai pas été convaincu par tout mais j’ai bien aimé les œuvres de David Hammons. Le lieu est très beau mais je cringe un peu sur la glorification de Pinault.



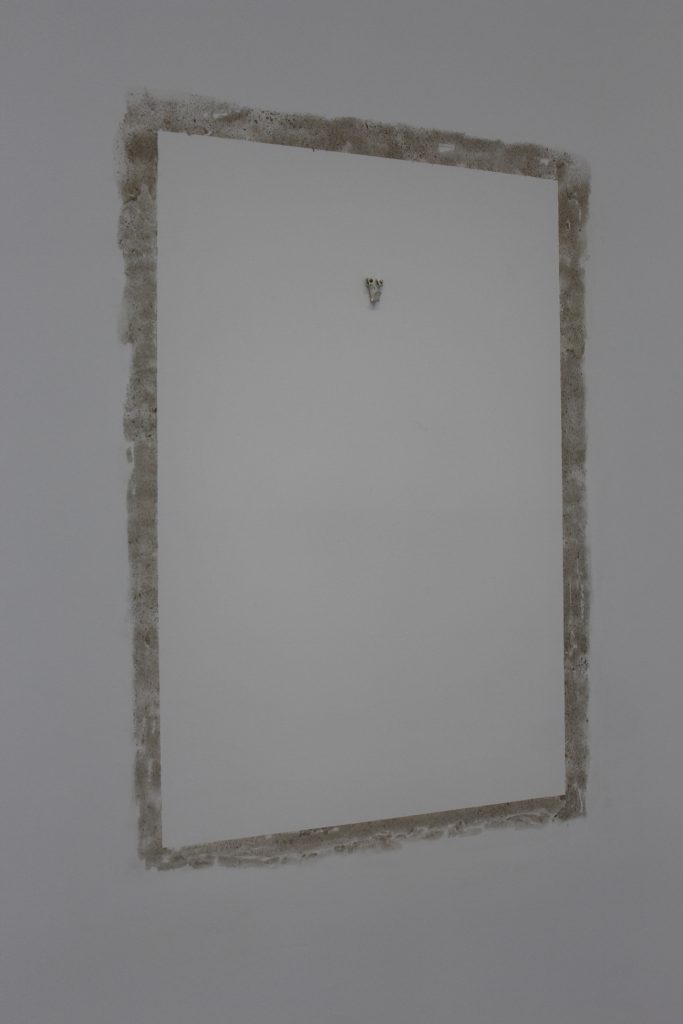



Visite des expos inaugurales de la Bourse du Commerce. J’ai pas été convaincu par tout mais j’ai bien aimé les œuvres de David Hammons. Le lieu est très beau mais je cringe un peu sur la glorification de Pinault.



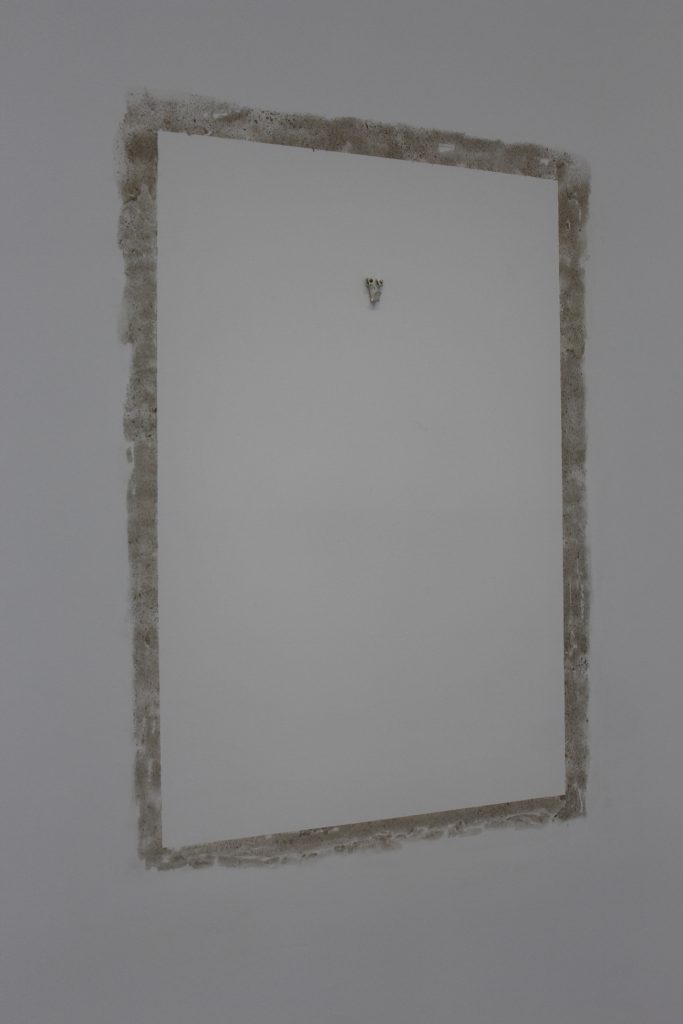



Film français de 2020. Ma Palme d’Or personnelle.
Youri, 16 ans, a toujours vécu dans la cité Gagarine à Ivry. Mais la démolition de la cité est programmée et elle se vide peu à peu de ses habitants. Youri va d’abord tenter de la réparer pour la faire échapper à la démolition, puis recréer l’intérieur d’une capsule spatiale dans les appartements abandonnés alors qu’il perd peu à peu contact avec la réalité…
Franchement j’ai tout aimé. Les deux grands fils de l’histoire – l’attachement à la cité et à son histoire, l’envie de départ incarné par l’appel de l’Espace – sont réussis et leur entrelacement encore plus. Les personnages sont crédibles et attachants, la romance adolescente est réussie. Les décors sont super, la façon de les filmer encore plus. La façon de tresser les parallèles visuels avec la conquête spatiale est très bien trouvée. La bande son est très bonne. Je ne trouve qu’un seul bémol, la fin est un petit peu longue, mais c’est un détail très mineur.
Grosse recommandation.
Roman états-unien de science-fiction. Un petit noyau d’humains arrivent sur Pax, une planète dans la zone habitable d’une étoile lointaine. Peu nombreux et ayant perdu des ressources durant leur long voyage, ils tentent de créer une société humaine basée sur la coopération et le pacifisme, tout en s’adaptant à la biologie de Pax. Ils découvrent rapidement que sur Pax, où la vie existe depuis bien plus longtemps que sur la Terre, de nombreuses formes de vie présentent une forme d’intelligence, la plus développée se trouvant chez différentes espèces de plantes, avec lesquelles les humains vont devoir coopérer.
J’ai beaucoup aimé. Chaque chapitre est centré sur un personnage d’une génération humaine différente, couvrant un siècle d’histoire et sept générations. On voit l’évolution de la compréhension des Humain.es de leur environnement et de leur relation avec différentes espèces. On a aussi à plusieurs moment le point de vue d’une plante, assez bien rendu, notamment la description de leurs relations avec les autres plantes, les différences de perception temporelle et de capacités de communication. C’est un roman de premierS contactS, avec des espèces assez originale. J’aime beaucoup notamment le fil de la rencontre avec les Glassmakers, et les différences radicales entre les attentes des Humain.es et la réalité du contact, et comment ce fait est lié à l’idéalisation des Glassmakers par les Humain.es comme une espèce qui parlerait d’une seule voix, parfaite et forcément plus avancée.
Film de science-fiction de 2020. Aux États-Unis, dans un présent parallèle, une nouvelle technologie qui sert de McGuffin permet à des compagnies de faire d’énormes bénéfices via du « quantum trading ». Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place de nouvelles infrastructures de calcul et surtout d’actualiser en permanence les connexions physiques entre elles en installant de nouveaux câbles. Dans les parcs nationaux, cette tâche est sous-traitée à des travailleurs précaires qui doivent acheter leur propre matériel et se logguent sur une application qui leur indique des routes à suivre, plus ou moins dures, permettant de récupérer plus ou moins d’argent. En parallèle, la compagnie envoie aussi des robots installer des câbles sur les mêmes routes, moins rapides mais avançant en permanence. SI le robot termine la route en premier, le travailleur indépendant ne touche rien…
Dans ce contexte, le protagoniste va commencer à câbler pour récolter l’argent nécessaire au traitement de son frère malade. Pour ne pas avoir à attendre une éternité que son permis soit approuvé, il passe par un mec shady qui lui loue un terminal de câblage qui avait appartenu à un autre travailleur détesté par les câbleurs, étant donné qu’il a travaillé avec la compagnie pour rendre les robots beaucoup plus efficaces…
Y’a beaucoup de bonnes idées et j’ai bien aimé l’ambiance et le commentaire social (Uber x la randonnée !), mais il y a aussi pas mal de défauts caractéristiques d’un premier film. Ca part un peu dans toutes les directions, y’a des éléments qui ne font pas vraiment sens alors qu’ils sont quand même assez important pour l’intrigue, le parallèle avec le capitalisme de plateforme dans notre univers est évident mais faut pas regarder de trop près les détails (pourquoi des robots plutôt que mettre plusieurs travailleurs sur la même route ?). La fin est très abrupte est pas très compréhensible. Mais ça donne assez envie de regarder les prochains films du même réal.
Roman polonais de 2009. La narratrice vit dans un hameau isolé sur un plateau dont les routes d’accès sont coupées en hiver. Un de ses deux voisins, braconnier, meurt d’un accident en plein hiver. Mais la narratrice est persuadée que les animaux se vengent des humains et s’attaquent aux chasseurs. Elle envoie une flopée de lettres aux autorités qui ne répondent pas et décide de mener sa propre enquête.
J’ai bien aimé. C’est assez difficile à décrire, l’ambiance est assez particulière. La narratrice est assez ermite, elle vit selon ses rituels et ses façons de faire les choses. Elle a des relations sociales normales, des amis, des connaissances, mais elle en a aussi rien à faire d’être considérée comme la vieille folle du coin par une grande partie de la communauté. Cela donne un point de vue assez spécifique et original.
Essai féministe sur l’influence du genre, des stéréotypes genrés et du marketing genré sur l’alimentation.
Globalement, le marketing des aliments est basé sur la pensée magique : les aliments auraient des qualités intrinsèques en sus de leur composition en lipides/glucides/protéines ; qualités qui seraient transférées à cellui qui les consomment : les carottes rendent aimables, les yaourts font mincir… On a là une excellente base pour rajouter une couche de marketing genré et de stéréotypes sexistes sur l’alimentation.
Typiquement, la masculinité hégémonique s’exprime dans l’alimentation par les grosses quantités, la consommation d’alcool, les aliments épicés, le salé et l’excès. A l’inverse la féminité hégémonique va se traduire par le contrôle, le sucré, les aliments nature… Dans les faits les hommes consomment plus de sucré que les femmes (la prescription sur le sucré clashant avec celle sur le contrôle), mais ce n’est pas l’image qui est renvoyée par la publicité ou les représentations culturelles, qui construisent bien plus le stéréotype genré que la réalité des consommations.
Ces assignations différenciées vont s’exprimer dans des contextes où il est important de performer le genre : typiquement les premiers rendez-vous d’une relation. C’est assez straightforward pour les hommes, ça peut être compliqué pour les femmes, avec des injonctions à être « une fille cool », ie celle qui se comporte comme un mec sur certains points tout en se conformant d’autant plus aux injonctions à la féminité sur le reste : commander un burger au restaurant mais surtout en restant mince, dans un double bind de beau niveau. Les injonctions sur la nourriture font d’ailleurs écho à celles sur la sexualité (on parle de plaisir charnel dans les deux, c’est assez logique) : les hommes sont supposés en redemander, les femmes être dans la retenue.
Derrière ces représentations, il existe tout un marketing genré qui mobilise les stéréotypes pour vendre des produits : soit directement (quand on vend des steaks aux hommes avec les mêmes arguments et le même vocabulaire que quand on leur vend des voitures ou quand on vend des yaourts aux femmes en leur rappelant leur obligation de rester mince), soit de façon plus convolue quand on vend des yaourts aux hommes : soit en repackagant le produit comme des broyourts, avec de plus grosses portions, un emballage noir et des arguments sur leur contenu en protéines ; soit en essayant de jouer au second degré sur les clichés en montrant un homme qui apprécie son yaourt comme une femme mais qui assume de briser les clichés (tout en restant un homme). L’autrice donne aussi l’exemple d’un marketing aussi assez tordu sur le chocolat pour les femmes, qui leur enjoint de « succomber à la tentation sans honte », ce qui veut surtout dire « appréciez le goût maintenant, prenez vous un retour de bâton sur les injonction au contrôle et à la minceur plus tard », à nouveau un double bind qui est un terreau pour les troubles de l’alimentation.
Roman français de 2021. Quatre mois après son atterrissage, la copie parfaite d’un avion de ligne réapparaît dans les airs. Les passagers sont mis au secret par le gouvernement des États Unis qui constate qu’ils existent en deux versions, une quatre mois plus jeune que l’autre.
C’était agréable à lire mais assez anecdotique, un peu de la SF pour personnes qui n’ont pas l’habitude d’en lire. Les deux points clefs c’est 1/ l’acceptation par les gouvernements et le monde que l’événement est réel, et ce que ça implique sur la nature de notre monde, et 2/ la présentation des vies des passagers, et l’impact que le fait de se rencontrer eux-mêmes avec quatre mois de décalage a sur leurs diverses trajectoires de vie. Et il y a un enrobage politique contemporain à base de Trump et Macron qui n’a aucun intérêt.
Mais bon voilà, les personnages sont attachants sans être bouleversants pour autant, il n’y a pas particulièrement un style d’écriture, le côté SF ne va pas très loin. Ça passe le temps mais ça remporterait jamais un Hugo, je sais pas trop pourquoi il a eu le Goncourt.
Virginie est une agricultrice qui s’est reconvertie dans l’élevage de sauterelles à la mort de son mari. Mais son exploitation périclite, les insectes ne se reproduisant pas assez, jusqu’au jour où elle découvre que le sang de mammifères est un formidable booster de croissance des orthoptères. Elle va alors cran hir de nombreuses limites éthiques l’une après l’autre pour assurer la survie de sa ferme et de sa famille.
J’ai beaucoup aimé le début du film, qui installe très bien l’ambiance, à la fois les éléments qui permettent une trame horrifique et un côté plus social de l’agriculture qui galère, du soutien et de la méfiance entre voisins, surtout envers cette activité non traditionnelle, et du rejet des enfants à l’école à cause de cette activité. J’ai aussi trouvé que la photographie était très belle, des plan superbes (notamment un où Virginie fumé une cigarette à contre-jour sur un crépuscule bleuté, avec la tache orange de la braise de sa clope). L’ambiance musicale est très réussie aussi, avec le crissement des sauterelles qui va s’intensifiant. Mais la deuxième partie du film – à partir du moment où tout est installé et que des sauterelles s’échappent de l’élevage – tombe dans un faux rythme. La tension s’élève puis retombe, les séquences se répètent, la menace que représente les sauterelles varie d’un moment à l’autre. C’est dommage parce qu’il y avait un très gros potentiel, les acteurs jouent très juste, mais le scénario ne sait pas gérer la partie horrifique/tension. Mais c’est prometteur pour les films suivants du réalisateur.
Roman français de 2014. Sixtine est une femme élevée dans une secte catholique intégriste. Mariée à 24 ans à Pierre-Marie Sue de la Garde qui va faire le coup de poing avec ses collègues de la Milice contre les gauchistes et les promoteurs du mariage pour tous, elle est supposée se réaliser dans son rôle de mère de famille et dans les sessions de prière. Mais via des amies issues de mouvements catholiques moins intégristes, elle a eu un aperçu d’une autre vie possible et n’arrive pas à se faire au rôle qu’on lui assigne.
J’ai bien aimé. Le livre décrit bien le fonctionnement en vase clos de la secte et les doutes de Sixtine. Warning, On a une focalisation de la narration sur son point de vue donc on a son opinion d’extrême droite sur pas mal de sujet, même si le livre remet pas mal ça en question de façon plus large, on peut ne pas avoir envie de lire ça.
La façon dont Sixtine quitté l’emprise de la secte et de sa famille est intéressante, le point de bascule qui est un mélange de refus des préceptes d’éducation des enfants de sa belle mère et la contradiction flagrante entre les préceptes habituels et la façon dont on lui dit que va s’appliquer à son cas qui lui montre que y’a quand même quelque chose qui ne va clairement pas. Le livre montre bien ses doutes sur le fait d’avoir fait le bon choix, le fait qu’elle quitte la secte mais garde en grande partie leur cadre de pensée, mais aussi qu’en se retrouvant dans un environnement différent elle voit bien comment beaucoup d’éléments ne tiennent pas, que les gens qu’on lui a présenté comme des monstres n’en sont pas.
L’ancrage géographique de la seconde moitié du livre dans le Tarn et l’Ariège était un bonus sympa, c’est marrant de connaître les noms de lieux et d’avoir des images réalistes de l’environnement de l’action en tête. Il y a peut être un peu d’idealisme dans la façon dont Sixtine s’intègre facilement à sa nouvelle communauté et dont les conflits s’apaisent, mais j’ai bien aimé néanmoins.
Ça se lit vite et c’est intéressant, sans être le roman de l’année c’est une bonne lecture d’été.
Essai de 2020 sur les évolutions du capitalisme à l’ère des firmes qui gèrent l’économie des données.
Durand détaille l’idéologie qui soutient les startups: plus que la mise en marché de tout, c’est l’application de la destruction créatrice (renommée disruption) à tout qui est au cœur du phénomène. Sur le papier, ça veut dire tout faire pour favoriser l’entrée de nouveaux petits acteurs sur les marchés qui vont pouvoir challenger les grosses firmes en place fossilisées dans leurs process, et donc ça justifie la flexibilisation du marché du travail, la dérégulation pour ne pas favoriser des méthodes spécifiques, etc…
Dans les faits, s’il y a eu une vague de nouveaux entrants sur les marchés numériques dans les années 90’s, les gagnants de cette période d’instabilité qui ont tiré leur épingle du jeu sont devenus les nouveaux monopoles et font tout pour ne plus être délogeables et rachètent les startups prometteuses depuis leur position de force. La concurrence exacerbée n’était pas un nouveau paradigme mais le moment d’un cycle des marchés.
En parallèle, l’intrusion du numérique dans le monde du travail a conduit à plus de contrôle des exécutants : les cadres sont nomades et autonomes (mais joignables partout et tout le temps), pour tous les autres il y a des scripts détaillés d’actions à faire et des indicateurs mesurés en permanence.
Enfin, la démocratie est érodée par la capture de la conversation publique par les médias de masse concentré entre les mains de quelques firmes et milliardaires. Ces médias personnifient les enjeux politiques, faisant qu’on ne se positionne pas sur des programmes mais sur des personnes (les médias ne sont pas les seuls responsables, les politiques s’engouffrent aussi à fond dans ce système, mais les médias l’accentuent au lieu de le contrer). Avec l’avénement des réseaux sociaux, le phénomène s’est encore accentué : même les déclinaisons entre petits groupes de personnes de la conversation publique sont médiées par des plateforme privées qui revendiquent d’utiliser leur position pour influencer le débat, expérimenter sur les gens, mettre en place du nudge et récolter des données. De plus il est difficile de quitter ces plateformes une fois qu’on y a investit du temps, construit son réseau de relations sociales, personnalisé leur fonctionnement et transféré nos données. On se trouve littéralement inféodé à ces plateformes, travaillant pour elles à créer des données qu’elles peuvent monétiser et avec de forts coûts sociaux rendant difficile de les quitter.
Durand effectue une comparaison entre les modes de production que sont esclavagisme, capitalisme et féodalisme : dans le féodalisme, les producteurs sont libres d’organiser leur production comme ils le souhaitent (les paysans gèrent leurs parcelles et leur temps comme ils l’entendent, contrairement aux salariés d’une entreprise), mais pas de changer de seigneur (saufs coûts prohibitifs dissuasifs, avec la nécessité de reprendre à zéro la culture d’une terre et de laisser tous les gens que l’on connaît derrière soi). L’économie de plateforme des GAFAM s’apparente, sur le point de la création/monétisation des données à ce système.