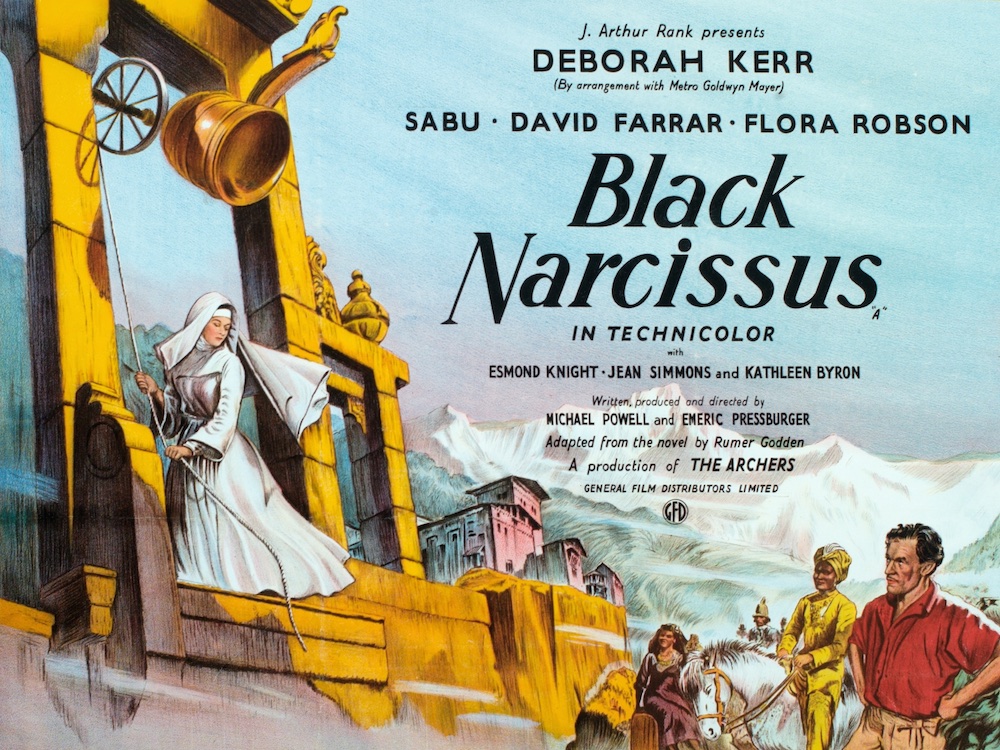Où Anna Kendrick joue Tintin dans On a marché sur la Lune.
Film germano-américain sorti en 2021. Un équipage de trois astronautes part pour un trajet de deux ans vers Mars. Ils vont rapidement découvrir qu’une quatrième personne a embarqué avec eux, posant rapidement un problème crucial : leur vaisseau ne recycle pas assez d’oxygène pour leur permettre à tous les quatre d’arriver jusqu’à Mars, et il n’ont pas assez de carburant pour pouvoir modifier leur trajectoire et retourner vers la Terre.
J’ai bien aimé le début : le décollage, les images de l’installation progressive des astronautes dans le vaisseau. Globalement tout ce qui est dans le vaisseau est joliment filmé, la tension due à la découverte du quatrième passager est bien rendue (mais on sent que le film aurait pu plus développer cette partie : les questions de 1/comment est-il arrivé là 2/a-t-il embarqué volontairement 3/est-il une menace pour l’équipage sont évacuées très rapidement (et carrément jamais résolue pour la 1). Du coup la tension est mise en place puis dissipée rapidement. Alors qu’il y avait des choses intéressantes à dire sur comment – quand tu t’es préparé.e à vivre 2 ans avec deux autres personnes avec qui tu t’es entraîné.e, que tu connais – tu gères l’arrivée inattendue d’un quatrième lascar dont tu ne connais rien et comment tu fais une place dans l’espace du vaisseau et dans l’organisation des journées à cette personne. Là tout semble se faire automatiquement.)
Le huis clos est bien mis en place, l’idée des communications avec la Terre dont le spectateur n’entend que les répliques des astronautes est très bien trouvée notamment, on ne voit vraiment que les quatre acteurs tout du long (et on entend juste une autre voix au décollage, ie les 5 premières minutes).
La répartition des rôles est intéressante aussi :
On a une commandante plus âgée et expérimentée – jouée par une femme mais dans un rôle que j’ai trouvé codé assez masculin – mais largement empêchée d’agir par un bras cassé, ce qui la force à accepter davantage ce que propose le reste de l’équipage. Toni Collette joue d’ailleurs comme d’habitude très bien.
Le personnage de David Kim est je trouve assez réussi aussi, dans la retenue et la frustration de voir ses expériences flinguées par les circonstances.
Le personnage joué par Anna Kendrick m’a moins enthousiasmé : perso féminin jeune et conventionnellement jolie, c’est celle qui exprime fortement ses émotions, est dans le care, et fait les blagues : elle est l’élément exubérant du groupe, d’ailleurs on la voit pas trop faire les expériences qu’elle est censée mener, elle est vraiment là pour faire avancer l’histoire.
Enfin le personnage de Michael Adams joue l’élément perturbateur : il n’a pas l’entrainement des autres, il est en position d’apprentissage ou d’impuissance, et sa présence est de base la source du problème. Les deux personnages masculins sont ceux qui font référence à une famille sur Terre quand les deux féminins ont l’air davantage sans attaches. Je suis par contre un peu dubitatif sur le fait d’avoir le seul personnage noir présenté tout du long comme l’outsider, au début comme une menace potentielle puis ensuite comme objet de débat entre les trois autres pour savoir s’il faut l’exécuter pour sauver la mission : les deux approches sont finalement écartées, mais poser ces sujets sans les lier explicitement à la race me semble dommage.
Enfin, la résolution du film. Là où ça pêche fortement pour moi. Le film m’avait été vendu comme un The Martian-like, où les personnages résolvent un challenge technique en détournant la technologie à leur disposition. Ce n’est pas l’enjeu du tout ici. Il y a une discussion morale sur le sacrifice de certains pour la survie du plus grand nombre mais qui est rapidement écartée, puis la solution trouvée ne présente pas de vrais challenges techniques : les obstacles sont très artificiels, au point que ça a causé une certaine suspension d’incrédulité chez moi : globalement le point clef est de grimper sur une corde, et pour ça ils ont un matos et des techniques qui sont particulièrement mal adaptés, alors que dans la vie réel l’ascension sur corde c’est un truc de base de l’escalade et de la spéléo : avoir deux points d’ancrage et du matériel auto-bloquant, pour le coup it’s not rocket science, et ça résout l’essentiel des difficultés de la fin du film. Perso je m’attendais à ce qu’ils aient davantage des problèmes de franchissement des panneaux solaires, qu’ils cassent une partie de l’alim électrique et que ça cause de nouveaux problèmes, mais finalement non pas du tout. Bref cette fin fait assez bâclée et je pense qu’elle souffre de la comparaison avec ce qu’on a pu avoir dans The Martian ou certaines séquences de la saison 1 de For All Mankind.
Globalement, de belles images, une prémisse (et des prémices) intéressante, mais un film qui n’en développe pas suffisamment les enjeux et conséquences jusqu’au bout en préférant s’offrir des facilités de scénario. Un bon jeu d’acteur et un sentiment de huis-clos très bien rendu cependant.