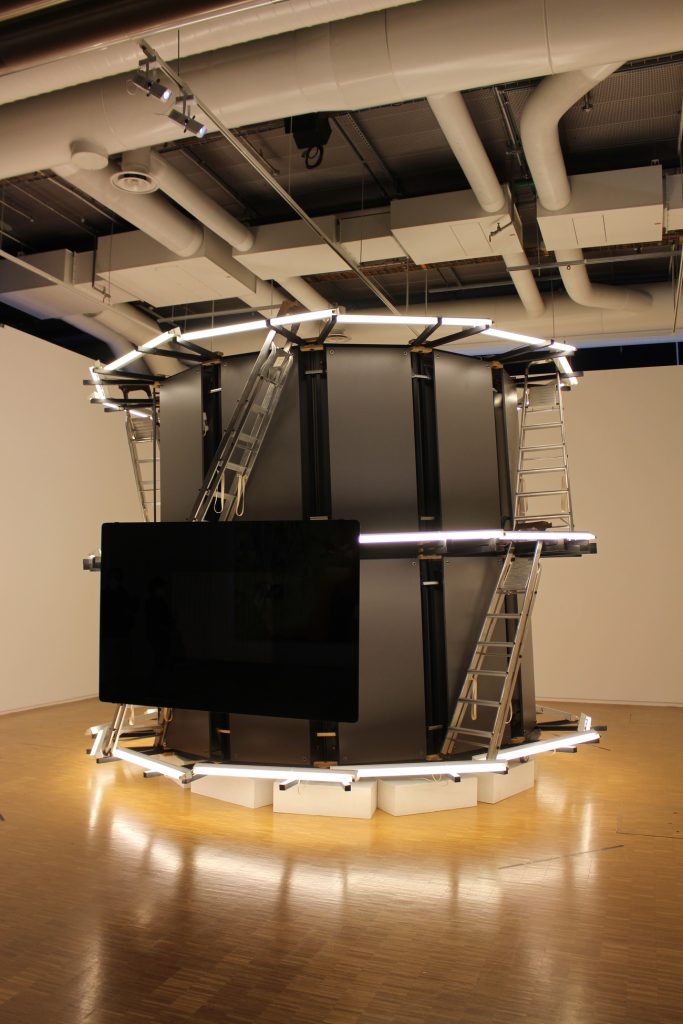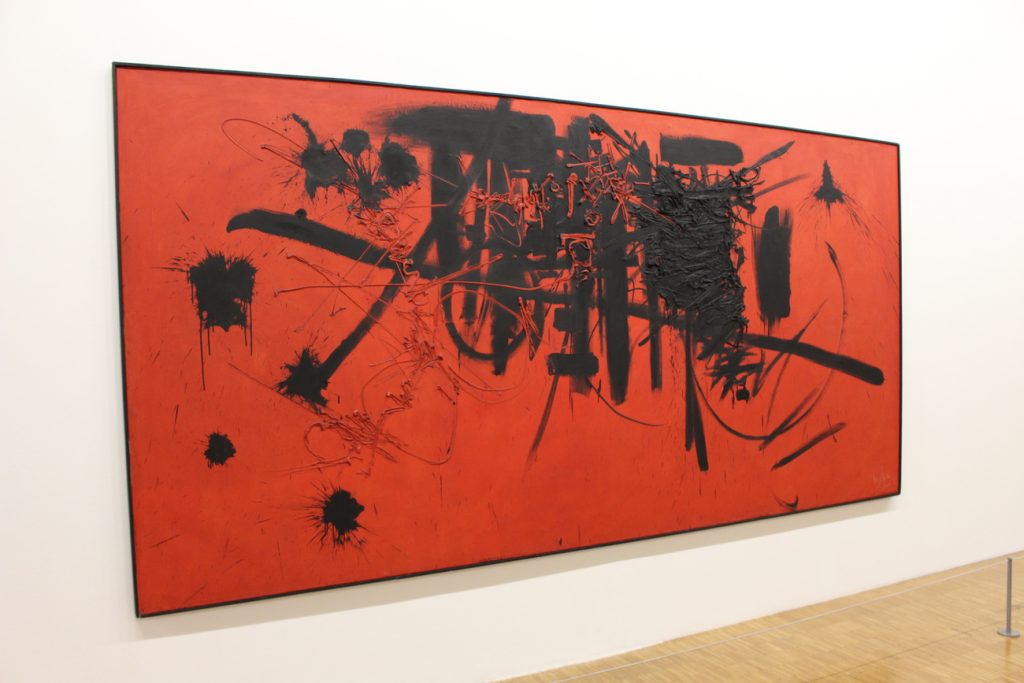Pour le point de vue d’OC sur le même roman, allez voir ici.
Roman de 2012. Au Québec, une femme est assassinée de façon sordide. Son mari va se mettre à la recherche du meurtrier, à travers le Québec, les réserves indiennes d’Amérique du Nord, les États-Unis. Toute la narration va être faite du point de vue d’animaux présents sur les lieux où le mari se rend.
Le concept est intéressant, mais j’ai été assez déçu par la réalisation. D’une part, le fil narratif à base de femme assassinée pour que des mecs puissent faire des affaires de bonhommes, bof. Surtout que le motif est réitéré plus loin. Y’a d’autres occurrences de violence assez gratuite par ailleurs, et clairement décrites avec trop de détails pour mon goût.
Et de plus, le côté « voix animales » est assez mal rendu je trouve : on passe par plein de narrateurs et d’espèces, mais à part pour quelques unes, le côté préoccupation et perceptions spécifiques à une espèces sont peu rendues : les animaux se préoccupent avant tout de la présence de cet humain spécifique dans leur environnement. Le style est par moment beaucoup trop ampoulé pour moi aussi.
Concept intéressant mais thème et réalisation décevante, je ne recommande pas. Lisez plutôt du Morizot pour des points de vue animaux.