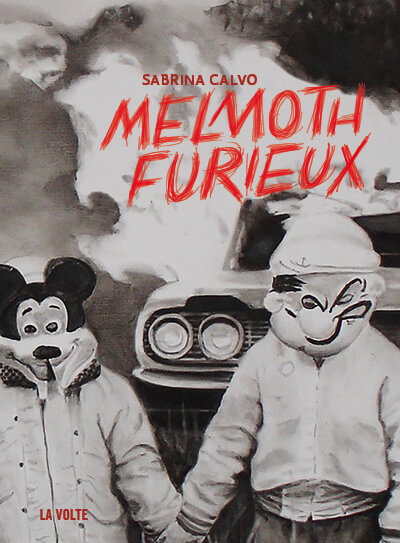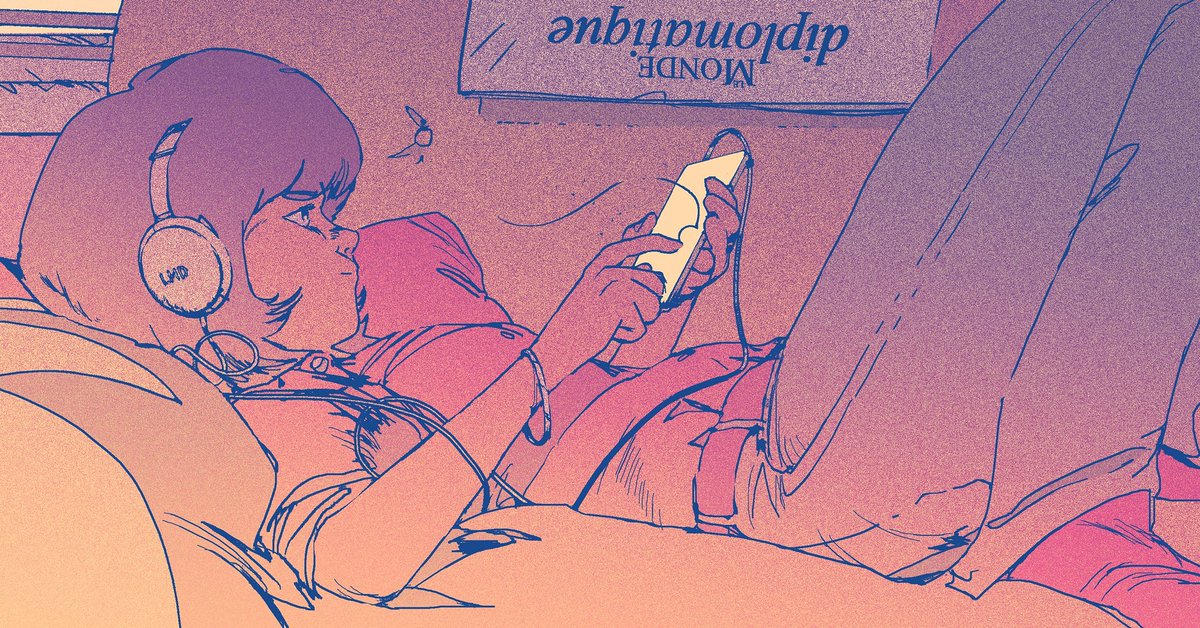Essai d’économie et de sociologie féministe. Il s’agit d’une compilation d’articles écrits par Delphy entre 1970 et 2001, sur le sujet de l’exploitation des femmes depuis une perspective marxiste. Delphy montre que les rapports hommes/femmes sont un rapport de classe, avec une classe exploitante et une classe exploitée. La classe des hommes bénéficie du travail gratuit des femmes, que ce soit du travail ménager ou plus largement du travail domestique (ie tout le travail effectué par les femmes dans le cadre de leur couple : ça inclut le travail ménager, mais potentiellement aussi la compta de l’activité de leur mari, des activités productives sur une exploitation agricole…). Ce que montre Delphy c’est que ce travail domestique recouvre de multiples activités, que le seul point commun qui en fait un tout cohérent est sa réalisation par des femmes, hors des rapports de production marchand, et sa captation par un homme. Les mêmes activités effectuées dans un autre cadre pourraient avoir une valeur d’échange, c’est vraiment la relation domestique qui donne un statut particulier à ce travail. Delphy montre aussi que ce statut de travailleur gratuit n’est pas stricto sensu réservé aux femmes : dans certains systèmes familiaux agricoles, les cadets (ou même plus largement tous les enfants sauf uns) peuvent avoir ce statut de travailleurs gratuit, un seul héritant de l’exploitation et de la position du père, tous les autres vivant à jamais dans une position subalterne.
Plusieurs articles s’emploient à démontrer en quoi les analyses qu’elle propose sont bien des analyses marxistes, qu’elle étend la méthode matérialiste à d’autres sujets que le rapport de domination salarial, mais que c’est bien une extension pertinente et non une trahison comme le faux procès lui a pu être fait. Liée à cette question est sa démonstration que le rapport de classe homme/femme est bien un rapport distinct du rapport salarial : ce ne sont pas « les capitalistes » qui exploitent les femmes dans le couple, en extrayant leur valeur via leur exploitation de l’homme : c’est bien une exploitation distincte, on ne peut pas tout ramener au capitalisme et absoudre les prolétaires hommes en couple hétéro d’une certaine position de domination.
Il y a aussi une analyse intéressante qui démontre en quoi non seulement le genre est socialement construit, mais le sexe aussi (bon c’est pas une surprise, avec la position matérialiste de Delphy, rien n’est immanent, tout est construit). En gros, se crée d’abord une relation d’oppression entre deux classes, qui fait advenir ces classes : on divise l’humanité entre hommes et femmes, en affirmant que la différence entre les deux est porteuse d’un sens profond qui justifie une différence de traitement et de socialisation (contrairement à la couleur de cheveux ou la latéralisation, par exemple), et que les catégories ainsi créées sont nettes et naturelles. Je ne détaille pas la partie où l’on attribue des comportements et des jugements de valeurs sociales aux deux catégories pour créer le genre, ce qui me semble intéressant ici c’est surtout la façon dont pour naturaliser l’oppression, on va lui chercher un support dans des différences physiques qu’on va cherry-picker : on déclare que les organes sexuels, les caractères sexuels secondaires, puis avec les avancées de la science les hormones, les chromosomes… tombent bien nettement dans deux catégories distinctes, de chaque côté de la barrière genrée, puis on va décréter que les cas qui ne s’y conforment pas sont anormaux dans le sens non-naturels, alors qu’ils le sont dans le sens où ils ne correspondent pas à une norme construite.
Globalement, très bonne lecture. J’ai eu un peu plus de mal avec le T2 (qui reste intéressant cependant), davantage basé sur des réponses à des controverses de l’époque, mais le tome 1 se lit très bien, les démonstrations de Delphy sont très claires, et son style d’écriture est super accessible, un point rare dans les essais je trouve. Et même s’il y a eu des évolutions importantes de la société depuis ses premiers articles, les analyses restent tout à fait pertinentes. Une très bonne façon d’aborder le féminisme matérialiste.