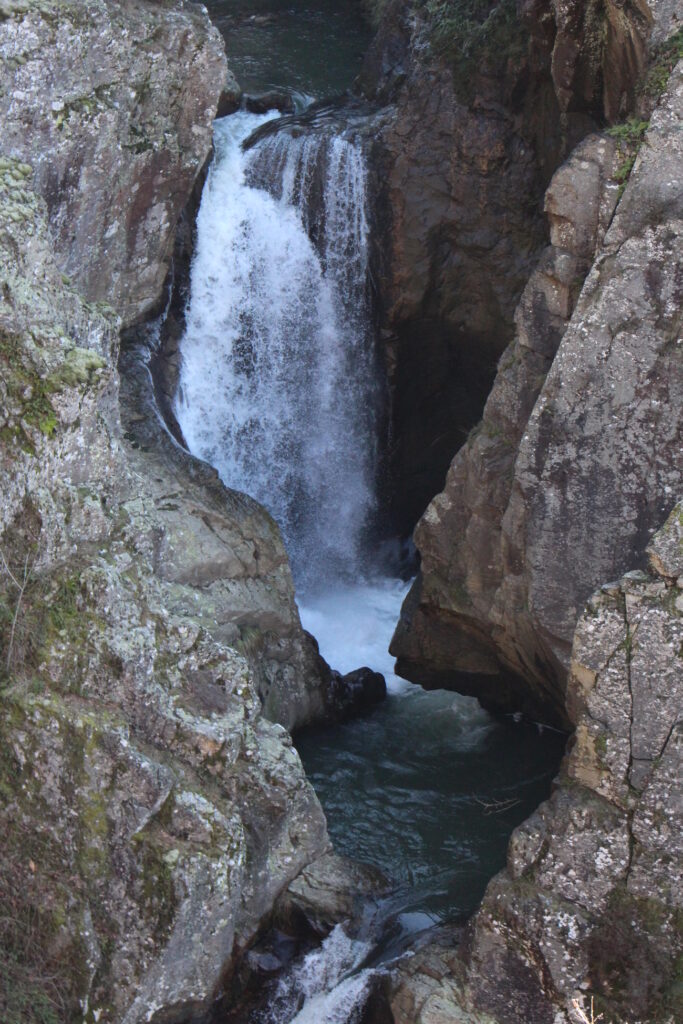Pièce vue à la scène nationale d’Albi. Hamlet est prince du Danemark. Le fantôme de son père lui révèle qu’il a été assassiné par son oncle, désormais roi. Hamlet décide de se consacrer entièrement à la vengeance, simule la folie, est odieux avec tout le monde autour de lui, et ça finit mal.
La mise en scène était très originale : les spectateurs étaient disposés à 360° autour de la scène, plusieurs acteurs jouaient Hamlet successivement, voir simultanément. Les acteurs prenaient parfois place dans le public, certains spectateurs étaient mis à contribution pour lire les lignes de personnages mineurs, et des drapeaux avaient été distribués dans le public représentant les nations mentionnées dans la pièce, que les spectateurs devaient agiter quand elles étaient mentionnées. Il y avait de la musique moderne et de la danse.
On pourrait craindre que toutes ces altérations fassent un peu gadget, et relèguent le texte au second plan, s’appuyant juste dessus pour des effets comiques qui marcheraient aussi bien avec une autre pièce. Je n’ai pas trouvé que ce soit le cas. Ce que ces modifications font, c’est mettre en lumière les conventions théâtrales, de façon réussie. Autant la n-ième répétition d’une pièce où les acteurs brisent soudain le quatrième mur pour aller se balader dans le public ça m’agace à force d’être suremployé, autant ici j’ai trouvé ça intéressant : le personnage d’Hamlet est marqué par un hoodie noir, indépendamment de l’acteur qui le porte, on distingue bien le personnage de l’acteur. Les changements d’acte sont annoncés par une voix off, ou directement par les acteurs. L’ensemble de l’espace de la salle est traité comme la scène, et le public comme des accessoires qui font pleinement partie de la pièce : le jeu avec les drapeaux marche notamment très bien : les drapeaux Danemark sont distribués massivement par rapport aux autres nations, illustrant les rapports de pouvoir politique dans la pièce et matérialisant aussi la cour du Danemark quand le roi et la reine s’assoient parmi eux : un tel effet serait difficile à réaliser sans rajouter une masse de figurants sur scène. Et si la troupe prend clairement plaisir à souligner les aspects comiques du texte, les passages tragiques ne sont pas relégués à l’arrière plan pour autant.